Sur l'ensemble du réseau halieutique
Étant alimentée par des nombreuses rivières (les streams), l'aire de répartition de la koï ne tarde pas à s'étendre à l'ensemble du réseau halieutique secondaire du plus long fleuve Néo-zélandais. Les sites de reproduction alors observés confirment un maintien de la population. Si son expansion verticale est bloquée, au Nord par la région d'Auckland (eau salée) et par les Hukka Falls au Sud (barrière naturelle infranchissable aux portes du Lac Taupo), elle progresse lentement vers l'Est. Elle s'établit également de manière sporadique dans certaines régions éloignées (Northland, Wellington…) et depuis une dizaine d'années dans l'île du Sud (notamment près de Nelson).
Par principe de précaution, et se basant sur des études australiennes, le département de la Conservation interdit l'introduction de la carpe koï et son transport dans tous les cours d'eau dès 1987, l'élevant au rang de poisson nuisible. En 1993, suite à la publication d'un rapport de ses présumés impacts sur l'environnement, sa remise à l'eau devient officiellement un délit pouvant conduire à 100 000 dollars d'amende et 5 ans de prison. Par cet acte, le DoC venait de sceller son sort : cette peste devrait être éliminée. On accuse la carpe koï de tous les maux : provoquer l'érosion des berges, détruire l'habitat des poissons indigènes et être à l'origine de la turpitude de l'eau. Il n'en fallait pas moins pour inciter les Kiwis à tout mettre en œuvre pour l'éradiquer : empoisonnement d'étangs, pièges, compétition de chasse à l'arc, tous les moyens sont bons pour tenter (en vain) de faire disparaître leurs silhouettes colorées de la surface frémissante de l'eau.

Le Koï Carp Classic, organisé chaque année dans la région, illustre parfaitement cet état d'esprit. Les quelques dizaines de passionnés (aux alentours d'une centaine) se réunissent pour l'occasion sur un plan d'eau préalablement sélectionné pour son potentiel. La compétition se tient sur deux jours, où la chasse est ouverte dès les premières lueurs du jour jusqu'à la pesée. En bateaux ou à pieds, les participants n'ont plus qu'à scruter l'eau à la recherche d'une silhouette rouge et à laisser s'exprimer leur « talent »! Et oui on parle ici d'un tournoi de « pêche » à l'arc ! Les chiffres sont vertigineux. Des tonnes de carpes sont tuées chaque année par quelques dizaines de participants, en seulement un week-end.

Contexte de pêche
La Région du Waikato, berceau de la carpe multicolore, constitue indéniablement le secteur à privilégier pour se lancer en quête de koïs. Au cœur de cette aire géographique de plus de 3 000 km², chaque pièce d'eau héberge une population de carpes. Les configurations y sont très diverses : fleuves, rivières, canaux et lacs offrent un terrain de jeu immense. La Waikato River est la colonne vertébrale du réseau halieutique. Elle offre un potentiel de pêche incroyable. Réputée pour son fort courant, elle présente cependant peu de zones de pêche accessibles. Elle est alimentée par de nombreux « streams », typologie de rivières sauvages, également peu profondes, peu ou pas entretenues, et donc très encombrées. Elles mesurent en moyenne une vingtaine de mètres de large. Ces cours d'eau sont tous soumis au marnage.
Le Lac Waikare (3400 Ha) et Lac Whangape (1450 Ha) constituent les plans d'eau principaux de la région. Comme tous les lacs du secteur, leurs profondeurs excèdent rarement les 2 mètres et la moyenne reste inférieure à 1 mètre, offrant de nombreux secteurs peu profonds tout aussi intéressants que déstabilisants à pêcher. On y trouve également une multitude de petits lacs magnifiques.

Tout comme le grand nombre de rivières qui arpentent ce territoire, ils sont difficiles d'accès (terrains privés, absence de dessertes), ce qui rend la prospection compliquée et concentre les pêcheurs sur quelques spots de pêche. Ceci est d'autant plus problématique pour les remises à l'eau. En effet, la délation ayant cours en Nouvelle-Zélande, relâcher ses poissons implique de trouver des postes à l'abri des regards. Les néo-zélandais ne sauront jamais vous dire pourquoi, mais la carpe est une espèce qu'il faut à tout prix éradiquer. Leur volonté sans faille de protéger leur territoire n'est pas usurpée et ils ne vous pardonneront pas ce geste si naturel soit-il.
Concernant le cheptel, il faut se montrer prudent. Très peu pêchées en Nouvelle-Zélande, les poissons record sont tous issus de la chasse à l'arc. On recense ainsi chaque année quelques rares poissons dépassant les 10 kilos, flirtant même parfois avec la barre des 15 kg. La moyenne est cependant très inférieure se situant à environ 3 kg. Pour autant, il faut considérer le nombre très important des poissons, et également la morphologie des plans d'eau, très peu profonds et donc peu propices à de fortes croissances. La densité joue en faveur des lois de probabilité et rend difficile la prise de gros poissons. Mais après tout qu'importe : le plaisir ne se mesure pas en kilogramme…

Absence de législation
Nous le savons, la législation est parfois absurde : trop restrictive, illogique, elle a tout de même le mérite d'encadrer une pratique. En l'absence de lois, le système tend nécessairement vers le chaos. Dans le contexte néo-zélandais, la carpe, de par son statut, est bien évidemment boudée par tous règlements. Elle se pêche partout, toute l'année, avec un nombre de cannes illimité, et sur chacune autant d'hameçons que de raisons. Pour faire écho à une problématique actuelle dans nos eaux, la pêche de nuit est autorisée partout et en tout temps.

Aucun permis n'est nécessaire, contrairement aux espèces sportives comme le gardon ou la tanche. Si pour la poignée de passionnés du cru (une trentaine en exagérant) cela peut paraître une aubaine, cela soulève de nombreux problèmes vis-à-vis des pêcheurs moins respectueux qui se voient mis à leur disposition un nombre incalculable d'armes pour détruire ces poissons !
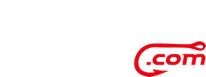
 /
/ 


















