Cette phrase, je ne la comprends pas. Pas vraiment. Je sais simplement qu'il me faudra du temps, pour saisir ce que cela veut dire. Elle sonne juste, mais je sais déjà que ce sera beaucoup de travail à venir.
« Ce n'est pas attraper qui compte, dit le pêcheur, mais essayer » René Barjavel.
Comprendre qu'est-ce qu'un acte de civilisation
Un acte de civilisation, c'est ce qui éloigne l'humain de la brutalité, de la barbarie, de l'indifférence ou de la domination aveugle. C'est un geste, un engagement ou une politique qui vise à élever la condition humaine, à renforcer la justice, la solidarité, ou le respect du vivant.
Ces actes peuvent être spectaculaires comme l'abolition de l'esclavage mais aussi du quotidien : protéger une espèce menacée, transmettre un savoir, préserver une rivière, éduquer à la protection du milieu aquatique.
Mais la pêche n'est elle pas souvent accusée d'être barbares par les animalistes ? Il serait naïf d'imaginer que tout acte de civilisation est pur. Comme le rappelle le philosophe Edgar Morin : « Il n'est pas un signe ou un acte de civilisation qui ne soit en même temps un acte de barbarie. »

Cette ambiguïté existe aussi dans la pêche de loisir. Pêcher, c'est prélever, interagir avec le vivant. Mais c'est aussi l'occasion d'apprendre à le faire autrement. La pêche de loisir, lorsqu'elle est pensée comme une pratique éthique et respectueuse, est, comme le disait Olivier, un acte de civilisation.
Pêcher, ce n'est pas seulement attraper un poisson. C'est être dans la nature et l'observer pour essayer de la comprendre.
« Seul le pêcheur sait le goût exact du matin, le goût du pain et celui du café de l'aurore. Il a, seul, ces privilèges exorbitants. Né subtil, il n'en parle pas. Il garde cela pour lui. C'est un secret entre le poisson et lui, l'herbe et lui, l'eau et lui. » René Fallet
La pêche met l'humain face à ses responsabilités.
Elle l'invite à faire des choix : prélever ou relâcher ? Respecter la frayère ou l'ignorer ? Transmettre un savoir ou garder ses secrets ? Agir seul ou avec les autres ? Elle devient humaniste quand elle incarne certaines valeurs fondamentales.
Elle respecte le vivant : le pêcheur prend conscience de la valeur de la nature et des poissons, il limite ses prélèvements, relâche les poissons quand c'est possible, ou pêche de manière éthique. Elle crée du lien humain : entre générations (pêche en famille), entre amis, ou à travers des associations (AAPPMA) où des bénévoles s'engagent pour le bien commun.
Elle éduque : en transmettant des savoirs, en initiant les jeunes au respect de la nature, en luttant contre l'indifférence ou la violence envers le vivant. Elle s'engage pour l'environnement : nettoyage de rivières, lutte contre les pollutions, préservation des milieux aquatiques. Elle défend un droit d'accès à la nature pour tous, sans distinction sociale, financière ou culturelle.
Mais elle ne l'est pas quand… Elle devient purement prédatrice ou égoïste : prendre sans limite, sans respect du poisson ou du milieu, ignorer les règles biologiques ou réglementaires. Elle exclut les autres : privatisation excessive des parcours, mentalité élitiste, rejet des débutants ou des pêcheurs différents. Elle est indifférente aux enjeux écologiques, aux autres usagers de la nature, ou à la souffrance animale.

La pêche associative
En France, la pêche de loisir repose sur un modèle associatif : les AAPPMA. Ces associations gèrent les milieux, entretiennent les parcours, mènent des actions d'éducation, de surveillance et de protection. Prendre une carte de pêche, c'est soutenir un engagement bénévole en faveur de la nature et du bien commun.
La pêche associative a aussi vocation à porter une vision :
Reconnecter la nature et la société : la pêche est un contre-pied aux logiques urbaines déconnectées du vivant, là où l'antispécisme se développe souvent dans un monde abstrait ou idéalisé.
Porter une action écologique de terrain : les pêcheurs, souvent les premiers à alerter sur les pollutions, à entretenir les berges, à surveiller les écosystèmes, agissent concrètement là où d'autres se contentent de slogans.
De rappeler la complexité écologique et de l'humilité nécessaire face au vivant : la nature n'est pas un monde de paix végétarienne. C'est un monde de relations, d'interactions, parfois de prédation. Y entrer, c'est apprendre à faire avec cette complexité, pas à la nier.
Le monde des réseaux
Les réseaux sociaux ont remplacé les cheminées. Autrefois, on accrochait un poisson empaillé comme un trophée silencieux ; aujourd'hui, on poste la photo d'une prise sur Instagram ou Facebook. Les likes ont pris la place des compliments familiaux, et chaque notification vient flatter l'ego du pêcheur.
Mais ce miroir numérique déforme la réalité : il donne une image fausse de la pêche et des captures. Une sortie sans brochet d'un mètre est presque perçue comme un échec, alors qu'un brochet de 80 cm est déjà un magnifique poisson, fruit de patience et de savoir-faire. Cette quête du spectaculaire occulte l'essentiel : la beauté du moment, l'équilibre du milieu, la rencontre avec le vivant. La pêche humaniste, elle, se vit dans l'ombre des écrans, dans la patience et la discrétion, là où l'essentiel ne se mesure pas en likes.
Cette illusion de grandeur entretenue par les écrans fragilise aussi l'image publique de la pêche. Aux yeux de ceux qui ne connaissent pas notre passion, elle apparaît comme une course au trophée, un loisir centré sur la performance. Cette perception, souvent fausse, alimente les critiques faciles et les jugements rapides. Pourtant, la réalité du terrain est tout autre : derrière chaque sortie, se cache une attention au milieu, une humilité face au vivant, et souvent des actions concrètes pour le protéger.
Le monde change, et les critiques contre la pêche évoluent. Elles viennent parfois de ceux qui n'ont jamais tenu une canne, mais qui projettent sur le vivant une vision idéalisée, abstraite. Loin du terrain, des rivières et de la vie réelle. À cela, il ne s'agit pas de répondre par la colère, mais par une intelligence collective. Celle de la pêche associative, de ses milliers de bénévoles, de ceux qui savent que protéger une rivière demande plus qu'un tweet.

Conclusion
La pêche de loisir devient un acte de civilisation quand elle refuse la brutalité, la surexploitation et l'indifférence. Quand elle cherche à comprendre plutôt qu'à dominer, à transmettre plutôt qu'à accumuler, à protéger plutôt qu'à prélever sans limite. Elle est profondément humaniste quand elle s'appuie sur la raison, le respect, la solidarité, l'éducation, le souci du bien commun, et s'inscrit dans une logique de progrès moral et écologique.
À l'heure où l'on parle de réconcilier l'homme et la nature, la pêche, si elle est pratiquée avec conscience, peut être une voie discrète mais puissante de transformation. Un espace de lien, d'apprentissage, d'engagement. Un lieu où l'on apprend non seulement à pêcher, mais à habiter autrement le vivant. Et dans ce monde en crise, chaque acte de civilisation compte. Même celui de poser une ligne dans l'eau, ouvert aux actes naturels, à ceux de la nature.
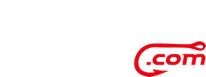
 /
/ 








